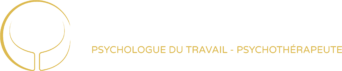DÉFINITION DES RPS ET CADRE JURIDIQUE
Le cadre juridique général en matière de santé au travail
C’est le principe de prévention des risques qui doit guider l’action des employeurs. Parmi ces principes généraux recensés dans l’article L.4121-2 du Code du travail, figure notamment la nécessité de :
- Éviter les risques : cela signifie supprimer le danger ou l’exposition au danger.
- Remplacer un produit ou un procédé dangereux par ce qui l’est moins, lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une solution présentant des dangers moindre
- Combattre les risques à la source : c’est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires
- Adapter le travail à l’homme : c’est par exemple l’adaptation des charges de travail ; choix des méthodes de travail et de production en vue par exemple de limiter le travail monotone et le travail cadencé ; …
- Informer et former les salariés
Ces principes généraux de prévention s’appliquent aussi bien à la santé physique que mentale.
Le cadre juridique spécifique aux RPS
- Loi de modernisation du 17 janvier 2002 : définition de ce qui doit être considéré comme constituant un harcèlement moral et mise en place les moyens de faire constater les éléments qui le constitue et de les faire sanctionner.
- L’accord inter-professionnel du 2 juillet 2008 rendu obligatoire par arrêté ministériel du 23 avril 2009.
– Propose des indicateurs pour dépister le stress au travail et un cadre pour le prévenir.
– Caractérise le stress : « un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses ».
– Impose à l’employeur de « prévenir, éliminer et, à défaut, réduire les problèmes de stress au travail ».
- L’accord précise que l’identification d’un problème de stress au travail doit passer par une analyse des facteurs suivants :
« L’organisation et les processus de travail : aménagement du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques d’horaires, degré d’autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis, une mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc. »
« Les conditions et l’environnement de travail : exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l’efficacité, à la chaleur, à des substances dangereuses, etc. »
➢ « La communication : incertitude quant à ce qui est attendu au travail, perspectives d’emploi, changement à venir, une mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l’entreprise, une communication difficile entre les acteurs, etc. »
➢ « Les facteurs subjectifs : pressions émotionnelles et sociales, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d’un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc. »
- Accord-cadre européen du 15 déc. 2006 sur le harcèlement et la violence au travail
– Transposé en droit français dans l’accord national du 26 mars 2010
– Apporte aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants un cadre pour l’identification, la prévention et la gestion du harcèlement et de la violence au travail.
– Sensibiliser l’ensemble des acteurs : employeurs, travailleurs et instances représentatives du personnel.
– Définition de la violence : « lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique,… ».
– Définition du harcèlement : « consiste en des abus, menaces et/ou humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail.
L’évolution du droit, jurisprudence : reconnaissance des lésions psychiques en AT
L’évolution de la jurisprudence des tribunaux français et européens est importante : des traumatismes psychologiques peuvent être imputés à la situation de travail et être caractérisé au titre des accidents du travail et cela en dehors de toute lésion corporelle. Cela peut être un malaise, une crise de larmes, un choc émotionnelle qui font par exemple à une altercation ou à une agression verbale.